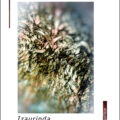MARIANNE DESROZIERS Trouville, côte Normande (première partie)
 A Marguerite Duras
A Marguerite Duras
Trouville, côte Normande. L’humidité colle à la peau. Les premiers frimas s’imposent. Le vent s’insinue sous les vêtements. Le soleil a du mal à percer derrière les nuages moutonneux. C’est la fin de l’été, presque le début de l’automne. Ca sent les embruns. On entend les cris des mouettes. On voit des bâteaux de pêche au loin. En arrière plan de belles et grandes maisons à colombages. Ici vivent les riches. Elle n’est pas d’ici. Elle ne vit pas ici. Elle ne vient pas ici en vacances chaque année, comme d’autres. Pour elle c’est exceptionnel. Elle a eu une importante rentrée d’argent alors elle a pu se payer deux semaines au bord de la mer. Elle en rêvait depuis longtemps. Dix ans au moins, peut-être plus. Alors voilà, c’est fait, elle y est. C’est les vacances. C’est Trouville. C’est la fin de l’été. C’est mieux, c’est plus tranquille, les touristes sont repartis. Elle est descendue à l’Hôtel des Roches Noires. Pourtant ce n’est pas aussi bien qu’elle l’avait imaginé, peut-être parce qu’elle se sent seule. Elle s’est fait des idées, elle a enjolivé la réalité, elle a imaginé des choses et comme d’habitude elle est déçue. Le réel la déçoit souvent. Peut-être est-ce sa solitude ou bien ce sentiment de nostalgie lourde et de vague regret propre à l’arrière-saison. Pourtant, il y a de belles surprises de temps en temps. Comme cet homme rencontré tout à l’heure et qui à présent marche à ses côtés, ici à Trouville, côte normande, entre deux saisons, entre deux époques. Il faudrait pouvoir en profiter sans se poser de questions, simplement, comme les autres parviennent à le faire.
L’homme relève le col de son long manteau en laine noir. Il frissonne. Elle non. Elle n’a pas froid. Elle est peu vêtue pourtant – pantalon en toile beige, caraco rose clair, sandales – mais elle a chaud depuis qu’il est là. De la racine des cheveux à la pointe des pieds, ça irradie, ça brûle. Elle se liquéfie. Comme lors de cet été caniculaire, il y a des années, qu’elle avait passé à boire des Bitter Campari sur la plage, ne faisant rien d’autre que ça, boire. Cet été-là, elle n’avait rien fait d’autre qu’avaler ce liquide rouge et amer, un verre après l’autre, sans temps mort. Elle se concentrait sur la sensation de l’alcool descendant dans sa gorge puis réchauffant son ventre et se diffusant dans tout son corps par les veines. C’était bon, terriblement bon dans l’instant. Quand vous buvez, vous annulez le temps, passé et futur n’existent plus, il n’y a plus que le moment présent, la seconde. Elle s’était détestée pour cette paresse. Elle qui n’aimait rien tant qu’être créative, productive. Elle qui adorait travailler. C’était un été gâché, un été pour rien. Elle ne veut plus d’été comme ça, jamais. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour que ça n’arrive plus. Se concentrer. Travailler. Oublier le reste. Ne pas céder aux distractions inutiles.
Elle sent la chaleur gagner jusqu’aux moindres recoins de son anatomie, ses chairs se ramollir doucement. L’exquise et insupportable sensation part du ventre et se diffuse dans tout le corps comme un alcool fort auquel elle à la faiblesse de céder puis qui la tient sous sa coupe sans qu’elle puisse jamais s’en défaire vraiment. Ce n’est pas son genre cet abandon, cette lascivité, ce laisser-aller du corps et de l’esprit. Mais quand ça lui arrive, c’est terrible. Elle ne parvient pas à résister. Elle ne sait pas se résister, résister à elle-même. Dans ces cas-là, elle pourrait faire n’importe quoi. Parfois elle le fait. Des coups de folie. Jusqu’à maintenant elle a eu de la chance mais un jour ça finira mal. Elle le sait. Ca finit toujours mal ces histoires-là pour ces femmes-là.
Elle en a honte au fond, tout au fond, de cet embrasement du ventre, de cet échauffement des sens, de ces picottements bizarres. Elle trouve ça un peu minable, sale, à la limite déshonorant. Elle n’aime pas se sentir autre, dépossédée de son identité. Elle aime tout maîtriser, son corps surtout. Que rien ne lui échappe. Pouvoir tout contrôler, chaque sensation, chaque mouvement, chaque réaction épidermique. Ou si ce n’est pas vrai, faire comme si. Que ça ne se voit pas son lâcher prise. Que les autres ne s’en rendent pas compte de son errance. Surtout qu’ils ne soupçonnent rien de son inconséquence. Elle aimerait qu’on pense d’elle qu’elle est une femme digne, qu’elle est une femme forte, une femme minérale, un roc, une femme comme on n’en fait plus. Une femme pas une femelle soumise à ses insctincts. Son imaginaire a la couleur de la nuit, c’est un cri dans la forêt : cette femme est une sorcière, qu’elle le veuille ou non.
Et que faites-vous donc dans la vie, à part boire des cafés en compagnie d’un charmant jeune homme ? En disant ça, il se hisse sur la pointe de pieds et se penche vers elle. Il est beau se dit-elle. Contre ça on ne peut rien. La beauté, c’est la grande injustice de la vie. Il est beau à en crever. Salaud. Elle le déteste pour ça, pour ça aussi. Et puis elle n’aime pas le ton de sa voix, sa légèreté empreinte de fausseté. Elle ne saisit pas tout à fait son humour, n’y est pas sensible. Il n’est pas si jeune. Au moins 40 ans, 45 peut-être. Elle le trouve un peu trop vieux pour elle qui n’en a que 30 même si elle en paraît plus certains jours quand une gravité déplacée et une lourdeur incongrue hantent son visage, durcissent ses traits, creusent des rides déjà. Elle sera laide quand elle sera vieille et elle est presque vieille déjà. Comme si avec elle, le temps avait pris de l’avance.
(à suivre)
Ce texte est publié avec l’aimable autorisation de Marianne Desroziers.
© Marianne Desroziers – tous droits réservés, reproduction interdite.
Suivre Marianne Desroziers sur fb