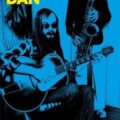chronique roman, nouvelles, récit
MAJOR DICK WINTERS, Beyound band of brothers
 La véritable histoire de l’homme qui a inspiré la série.
La véritable histoire de l’homme qui a inspiré la série.
Quelques années après son film Il faut sauver le Sergent Ryan, Steven Spielberg accompagné et épaulé par le « héros » du film, à savoir Tom Hanks produisaient la série Band Of Brothers, l’épopée de la compagnie de parachutistes la Easy Company. Le succès est phénoménal, à tel point que, 20 ans après, paraît ce livre, témoignage direct du Major Dick Winters (avec l’aide du Colonel C.Kingseed, pour le texte, et de Davide Fabbri pour les illustrations) qui y relate les missions dédiées à cette compagnie pas tout à fait comme les autres.
Nous allons tout de suite déminer le terrain en disant que si le major Dick Winters est patriotique, sans aucun doute, il n’en fait pas un étalage nauséabond comme les américains ont généralement tendance à le faire. C’est une très bonne chose, car ce qui l’intéresse principalement, c’est l’homme, c’est LES hommes qui ont combattu pour un idéal. Celui-ci, comme l’avoue l’ancien militaire, lui était sorti de la tête lors de ces missions, accaparé qu’il était au combat et à faire en sorte que ces hommes ne meurent pas.
Mais lorsqu’il délivra un camp de concentration, pas très loin du nid d’aigle de Hilter, cet idéal lui revint subitement en tête. Il dit :
« Au cours de la guerre, je m’interrogeais souvent sur les raisons de mon existence : « Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi dois-je endurer ce froid glacial, cette pluie incessante et la perte de tant de camarades ? Tout le monde s’en fiche éperdument. » Un soldat affronte au quotidien la mort et sa vie n’est que misère et privation. Il a froid, il a faim, et se retrouve même fréquemment à la limite de la famine. Après le premier choc passé d’avoir vu ses misérables derrière des barbelés, je trouvais les réponses à mes interrogations : « Maintenant, je sais pourquoi je suis ici ! Pour la première fois, je comprends les enjeux de cette guerre. »
De l’entrainement à la fin de la guerre.
Si ce passage montre l’humanité du major, le livre est au diapason. En effet, il n’a de cesse de dire qu’il n’aime pas se servir d’une arme à feu, qu’il en fait usage pour protéger ses hommes, ses compagnons, ses frères, comme chacun d’entre eux le ferait dans de pareilles circonstances. Cette relation presque fusionnelle, décrite plusieurs fois au cours du livre, remonte à la préparation des soldats. Dans l’adversité de celle-ci, car elle est particulièrement rigoureuse, il se crée un lien très fort, celui s’apparentant à une véritable fratrie. Ce lien ne fera jamais défection, sauf lorsqu’un des leurs tombe au combat.
Les hommes sont capables de se reconnaître « même dans la nuit noire », savent qu’ils peuvent compter les uns sur les autres. Ils ont aussi ce feu sacré, celui de suivre leur chef au combat, non pas pour tuer ou massacrer, mais pour atteindre un objectif. Le Major Dick Winters est cet homme, un homme pieux, qui ne boit pas d’alcool (à l’exception d’un verre de cidre après une prise importante, quelques heures après le débarquement en Normandie), qui montre l’exemple véritablement, sans se cacher derrière son grade. Un large chapitre en fin de livre est d’ailleurs consacré au leadership, à comment être un chef. Très lucide, il dit simplement que cela ne se commande pas (sans mauvais jeu de mot), c’est vraiment personnel à certaines personnes.
L’humilité qui court des lignes nous démontre, contrairement à cette géniale phrase de Desproges qui dit « il ne faut pas désespéré des imbéciles. Avec un peu d’entrainement on peut en faire des militaires », qu’il faut de l’intelligence pour diriger une compagnie et aboutir à des objectifs, pour le bien de tous. Jamais, il ne met ses exploits en avant, jamais il ne tire la couverture sur lui. Pour lui, il n’est pas un héros. Ceux qui le sont, ce sont ceux qui ont laissé leur vie en Normandie, en Hollande, à Bastogne. La célébrité soudaine aisni que les honneurs arrivés en 2001 n’y changeront rien. Il reste fidèle à ses hommes et à sa conception du devoir.

Des pertes faramineuses.
La compagnie à une taux de perte de 150%. C’est elle qui était envoyée là où le pire était attendu. Jamais les hommes ne rechignèrent, conscients qu’il fallait bien quelqu’un pour faire le job. Ce sens du devoir, s’il a ces inconvénients (on a pu le voir du temps pas si éloigné de Trump et de l’attaque du Capitole), a aussi ces avantages, et surtout ces récompenses. Car les survivants, mais aussi les défunts, furent mis en lumière par cette série.
Nous portons aussi une attention toute particulière aux illustrations. En effet, elles augmentent le caractère documentaire de ces mémoires. En noir et blanc, sobres et réalistes, elles nous plongent une nouvelle fois dans l’enfer de la guerre, mais plus dans les coulisses de celle-ci, ou dans des phases quotidiennes, mais aussi dans ce que les liens entre les hommes peuvent créer.
Enfin, nous notons également que si le Major Dick Winters abhorrait les nazis, il savait faire la différence avec les soldats de l’armée régulière qui, comme lui, exécutait des ordres. C’est toujours un peu bête à dire, mais il faut le répéter, l’armée allemande n’était pas forcément nazie.
Pour conclure, nous citerons une nouvelle fois une phrase forte : « Pour nous de la Easy, et pour ceux ayant servi leur patrie sur d’autres théâtres, nous sommes devenus meilleurs à l’issue des combats menés, et, sans aucun doute, la plupart repartiraient s’ils le devaient . Toutefois, s’il y a bien une chose que chacun d’entre nous doit retenir, c’est que la guerre est absurde et que nous espérons sincèrement qu’elle ne recommencera plus jamais. » L’histoire, malheureusement, ne lui a pas donné raison.