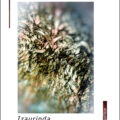chronique roman, nouvelles, récit
KARIM MADANI, Queens Gangsta (paru aux éditions Rivages)
 Dans l’enfer du Queens.
Dans l’enfer du Queens.
Queens Gangsta est une plongée, en apnée, dans l’univers glauque du Queens du milieu des années 80, à l’heure du règne de Reagan et des dealers de crack. Avec une langue qui sent à plein nez la street cred’, Karim Madani nous offre un roman puissant ainsi qu’un regard lucide sur une jeunesse sacrifiée.
La Suprême Team est le plus gros fournisseur de dope du Queens. Kenneth « Preme » McGriff et Gerald « Prince » Miller, oncle et neveu, ont monté leur petite entreprise de deal qui approvisionne tout leur quartier et fait d’eux la cible de la concurrence et des divers services de police. Queens Gangsta raconte leur histoire, leur ascension vertigineuse, tout comme leur chute, aussi abyssale qu’ils ont pu tutoyer les nuages.
Gosses pauvres.
Dans le Queens, t’as aucun espoir. Toutes les issues de sortie sont bouchées dès que tu y prends ton putain de premier souffle. Impossible de t’échapper des griffes du quartier. Tu y vis, tu y crève, dans l’indifférence la plus totale, en ramant pour vivre décemment. Mais parfois, une idée te traverse l’esprit. Alors si t’es malin, si t’es capable de t’adapter, tu peux faire la nique à ta destinée.
C’est ce que ce sont dit Preme et Prince en commençant leur entreprise de deal. Méthodiques, organisés et surtout très intelligents, ils mettent en place une politique efficace d’approvisionnement de poudre et de fiole qui fera d’eux les Kings du Queens, dans sa partie South Jamaica en tout cas, même si leur réputation dépasse ces frontières. Entre le guet, la distribution, la logistique et la gestion des écarts de conduite, réglés à l’aide de Magnum et/ou de Glock, c’est un véritable empire que gèrent, avec un cercle de proches et d’hommes de confiance, les deux hommes.
Inspirant la crainte et le respect, leur empire se situe entre quelques blocs d’immeubles. Forcément, il faut avoir des nerfs d’acier, surtout quand tu dois régler le problème de quelques indiscrets d’une balle dans la tête. Mais, ont-ils véritablement le choix à l’heure où l’administration de Reagan coupe ses vivres aux noirs et autres minorités ethniques qui voient, dans la drogue, un moyen de vivre comme des rois.
Conscience.
Avec une langue vive, ponctué d’interjection du type « mec », « homie », comme si Karim Madani, ou Prince, s’exprimait directement à nous, et forte en images, l’auteur nous plonge au cœur d’un sanctuaire, celui du code de la rue, celui dans lequel tu ne balances pas ton pote. D’une précision redoutable, d’historien du crime, il nous relate l’histoire de la Suprême Team, celle de gamins désœuvrés qui se lancent à corps perdu dans le trafic.
Mais justement, en se lançant à corps perdu, ils en perdent leur âme. Prince a perdu la sienne quand il a refroidit son premier type. Pourtant, il est « sympa » Prince. Par exemple, il est fasciné par les avions. Ils les regardent depuis les toits des HLM du South Jamaica et, comme un gosse, il les suit du regard jusqu’à ce qu’ils disparaissent dans le ciel azuréen. Dans le même ordre d’idée, même la pire des racailles, Henry Bolden, quand il doit se faire discret, montre qu’il est malgré tout un être humain, avec des aspirations très modestes.
En jouant sur cette ambivalence, Karim Madani évite le piège du stéréotype. Il nous rend ces crapules presque sympathiques, ce qu’elles auraient pu être en d’autres lieux, et surtout si elles n’avaient pas été noires ou basanées de peau. Sans être une œuvre sociale, Madani n’hésite pas à pointer du doigt les ravages de la politique de Reagan, mais également du racisme et du ghetto où sont entassées des populations de laissés pour compte.
Humanité.
Il nous décrit donc une logique implacable de business, de ses premiers pas, de ses premières trouvailles (les lâchers de pigeons voyageurs pour alerter les distributeurs de l’arrivée imminente des condés), de son développement jusqu’à son écroulement. La langue est poétique parfois, musicale, très cinématographique, mais surtout d’une vivacité surprenante car si les phases de descriptions sont nombreuses, elles sont aussi percutantes que les dialogues (qui ne manquent pourtant pas de piquant).
Les « héros » deviennent vite des proches. On en oublierait qu’ils tuent à la moindre suspicion. Régler les problèmes, dans le Queens, ça se fait à coup de dialogue de calibre .32. Pourtant, comme nous l’évoquions plus haut, ils n’en demeurent pas moins humains. Lorsque les choses se gâtent pour eux, les différents protagonistes se rendent compte qu’ils n’ont jamais connu la joie simple de rentrer du boulot et de retrouver chez eux femme et enfants.
Ces joies simples, qui leur sont interdites, contrastent violemment avec le fantasme que nous, qui avons des vies bien rangées, avons des gangsters. Brasser des tonnes de fric, ressentir les pics d’adrénalines lors d’une confrontation avec les flics, ou lorsqu’on doit exécuter un mec un peu trop bavard, tout cela nous évoque évidemment plein de films sur le thème parfois rabâché du banditisme à l’américaine.
D’une profonde justesse.
Karim Madani parvient à rendre son livre unique. Parce que nous sentons chez lui un profond amour de ses personnages, une sensibilité qu’il met en exergue là où d’autres forceraient le trait des bandits sans états d’âme, mais qu’il relate aussi une culture de la rue au plus près d’une (pour ne pas dire de la) réalité. Cette culture se ressent à la fois par les références musicales qui émaillent le texte, mais aussi par cette vérité descriptive. Nous parlions en introduction de street credibility, il est clair que l’auteur met un poing d’orgue à coller au plus juste de la vérité.
Par ses différents aspects, Gangsta Queens nous avale littéralement, et se lit de la même traite qui consiste à sniffer un rail de coke, pour le même résultat en matière de sensation. Puissant, humain, conscient, ce livre a véritablement tout pour plaire, car non seulement il est divertissant mais en plus il nous offre une réflexion sur la jeunesse et les rêves brisés par des gouvernements de gestion sans la moindre trace d’humanité. Puissant.
Nota : ce roman, paru dans la collection rivages/noir, et le deuxième de la série New York Made In France. La série, après Viper’s Dream, s’avère de très belle qualité et offre un regard autre de ce que nous offre justement la culture américaine. Salutaire en un sens.