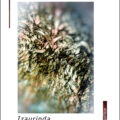chronique roman, nouvelles, récit
GUIDO MORSELLI, DISSIPATIO H.G (aux éditions Rivages)
 Quand tout le monde disparaît…
Quand tout le monde disparaît…
Dissipatio H.G de Guido Morselli n’est pas un roman comme les autres. Tout d’abord, le livre est sorti en 1973 et jouit, pour cette réédition, d’une nouvelle traduction. Mais ce n’est pas cela qui fait son caractère unique. Sorti en 73 donc, il fut un échec retentissant pour son auteur, qui se suicida après avoir reçu, une fois encore, des réponses négatives quant à une publication. Auteur manqué ou auteur maudit, peu importe tant son livre, aujourd’hui considéré comme un livre culte de l’autre côté des Alpes, nous parle en creux de son auteur et de son désespoir n’avoir jamais été édité de son vivant.
L’histoire est simple et terriblement complexe à la fois. Un homme, las de la compagnie des hommes, décide de se suicider dans une grotte pas très loin de chez lui. Mais arrivé sur site, dans la nuit du 1er juin, il renonce à accomplir son geste. Il retourne donc chez lui, et s’endort simplement dans son lit. À son réveil, il remarque qu’il est seul, totalement seul. Après quelques investigations, la lumière se fait : tous les êtres humains ont purement et simplement disparu de la surface de la Terre.
Post apocalyptique.
Ce roman pourrait avoir des allures de récit post apocalyptique, ce qu’il n’est pas véritablement. En effet, si la disparition subite de la totalité de l’humanité moins une personne ressemble à s’y méprendre à de la science-fiction pure et dure, ce qu’il est réellement en fin de compte (même si cela est fortement nuancé), le livre s’avère philosophique et engagé. En effet, ce livre va plus loin que le postulat de départ aurait pu laisser entendre. L’auteur y parle concrètement, entre autres choses, des effets de la solitude. Un exemple criant : l’homme veut consigner ses pensées par écrit mais s’y refuse car, à quoi bon, puisque personne ne pourra les lire ? Cela renvoie fortement au ressenti de l’auteur qui écrivait pour être lu, mais qui n’a jamais été publié de son vivant.
Plus loin encore, il y est question du constat de ce monde capitaliste dévorant (au début des années soixante-dix, rappelons-le, donc poussez allègrement le curseur pour le situer à l’époque actuelle). Les hommes ayant disparu ne reste que leur « empire » : aéroport vide, hôtels vides, villes vides. Ceux-ci sont réinvestis par les animaux sauvages, tandis que les animaux domestiques trouvent petit à petit la mort, n’ayant pu être nourris de la main de leurs maîtres. Ainsi, toujours en exemple, l’homme découvre au hasard de ses déambulations, un camion de livraison de volaille dans lequel tous les poulets ont trouvé la mort, dans des cages, faute d’avoir pu être livrés et nourris. La solitude ronge donc l’homme, un misanthrope forcené, qui finalement réalise qu’il aimerait bien revoir ses congénères.
Capitalisme et écologie.
Et il y a aussi, encore en rapport avec ce monde capitaliste, l’idée que l’homme seul aura de quoi subsister jusqu’à la fin de sa vie grâce à l’abondance de victuailles à disposition (qui nous interroge donc sur un aspect de surconsommation car, ramenant à plus petite échelle, il est bien question d’avoir à sa disposition plus qu’il n’en est besoin). Il pose aussi la question, pas vaine du tout, du « quoi faire de sa vie puisqu’on a tout à disposition ? Vivre dans la dictature du loisir ?
En un sens visionnaire, il sentait déjà la dérive du capitalisme dévorant, comme un Thoreau, d’ailleurs cité dans le livre, voyait à son époque que le bien matériel étouffait l’âme.
Réalité, ou rêve, ou mort parallèle ?
Il nous est impossible de savoir ou de comprendre si toute cette histoire n’est qu’un rêve suite à l’acte manqué du suicide, un mécanisme du cerveau donc qui aurait inversé la polarité d’une réalité délicate à vivre pour l’homme, ou si, en quelque sorte, l’homme se retrouve tel un fantôme, une fois mort donc, sur le négatif de la vie réelle qui continuerait à se dérouler normalement. Ou peut-être s’agit-il véritablement d’une réalité fantasmagorique, cruelle ? Ce flou, dérangeant, nous maintient captifs, réceptifs aussi aux questionnements existentiels de cet homme plus fragile que ne le laisse paraître le début du livre.
L’écriture est exigeante, précise, part dans des considérations philosophiques poussées, en questionnant autant sur notre système de consommation que sur ces fameuses et éternelles questions du « Qui suis-je ? Où vais-je ? » Comme évoqué plus haut, le livre interroge aussi sur l’empreinte de l’homme sur le monde, d’écologie, à l’époque pas si lointaine du premier choc pétrolier, prouvant que l’auteur, bien conscient de son environnement et de son territoire, s’engageait dans une réflexion profonde sur le monde tel qu’il était.
L’image en miroir de l’auteur.
Mais peut-être que ce qui nous touche le plus, c’est que derrière la fable « dystopique » se découvre la vie de Guido Morselli. Comme l’auteur, l’homme vit dans la montagne. Si l’homme y est seul suite à son acte manqué, Guido Morselli se trouvait seul avec ses livres sur les bras puisque personne ne voulait les publier. Impossible de ne pas y lire un désespoir, celui de l’auteur que personne ne lit.
Forcément, la question du suicide est omniprésente, comme si l’auteur indiquait déjà qu’il allait connaître l’irréparable. Ce qu’il fit avec ce nouvel échec. Nous y sentons un besoin de réponse, comme si, en quelque sorte, l’auteur demandait à un potentiel lectorat les raisons de son incapacité à être lu (qui ne dépendait pas plus de lui que la disparition de l’humanité n’incombait à l’homme du roman). Cette solitude, ce désarroi, cette incompréhension n’empêche cependant jamais Dissipatio H.G de dépasser le cadre du simple auteur qu’était Guido Morselli car il interrogeait déjà d’une dérive d’une société qui semble, depuis quelques années, marquer le déclin d’un modèle.
Conclusion cynique.
En épilogue de ce livre, nous découvrons qu’un an après son suicide, une célèbre maison d’édition transalpine décida de publier l’intégralité des œuvres romanesques de Guido Morselli. On ne peut s’empêcher de penser qu’il s’agit là d’un cynisme terrifiant. Même si une telle œuvre se devait objectivement de voir le jour, elle aurait dû l’être bien avant l’acte final de cet auteur (cette maison avait reçu des demandes de la part de Morselli, elle connaissait la qualité des écrits mais qui, sans doute pas assez vendeurs à son goût, avait refusé de les publier). Mais nul doute qu’ayant atteint le rang d’objet culte, ce roman aura rapporté pas mal d’argent à la maison d’édition. Horrible.
Cela nous interroge encore une fois, à fortiori, sur la consommation et le modèle économique capitaliste (pour ne pas parler du monde des grandes maisons d ‘édition qui ne promeuvent plus d’auteur.e.s ayant des choses à dire mais qui produisent (oui il s’agit bien de produit et non d’oeuvre) du prémâché, de prêt à lire, comme de la confiture à des cochons). Bref, comme un pied de nez, ou comme un message post mortem d’un auteur qui aura succombé à ses rêves inaccomplis…