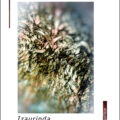CÉLINE SAINT-CHARLE Dans l’armoire du couloir

Nouvelle de notre autrice du mois.
Céline Saint-Charle nous a offert une longue nouvelle que nous vous proposons de découvrir sans tarder. Pas de longs blabla, la nouvelle parle d’elle même.
Dans l’armoire du couloir, sous les nappes du dimanche
J’ai grandi dans un village entouré d’une terre noire et fertile, dans la région bordelaise. Un tout petit village de rien, perdu, isolé au bout d’une route à peine assez large pour laisser passer une charrette. Un village qui, malgré sa petitesse, employait un cantonnier à l’année pour assurer la possibilité aux rares voyageurs d’arriver jusqu’à nous sans encombre, tant la végétation luxuriante, les haies sauvages qui bordaient la route, menaçaient à tout moment de nous couper tout à fait du reste du monde.
Il serait d’ailleurs plus juste de dire que j’ai vécu dans ce village, je n’y ai pas seulement grandi. Je ne l’ai pour ainsi dire jamais quitté, je n’ai pas voyagé, je n’ai rien vu du vaste univers, à l’exception de quelques rares incursions à la ville, pour signer des papiers, ou, hélas, de plus en plus fréquemment, pour consulter un spécialiste de ceci ou de cela.
Je vais fêter mes quatre-vingt-sept ans cet hiver, et mon vieux corps fatigué n’est plus aussi vaillant, il s’use, il s’abîme, des morceaux se brisent. Je me sens comme un torchon trop sollicité, qui se délite, brin de coton après brin de coton.
J’ai passé toute ma vie sur ce lopin de terre, parce que je l’aime, du plus profond de mon être. J’y suis attaché, ce sont mes racines. C’est aussi ma pénitence, le rappel incessant de mes fautes, sans espoir de la moindre rédemption. Je mourrai sans doute bientôt, et je pourrai enfin trouver le repos, ne plus laisser mes yeux subir ce voile noir permanent qui a coulé de la tristesse sur mon existence.
Avant de mourir, je dois toutefois avouer, crier la vérité, rétablir la justice, pour que les générations futures sachent ce qu’il en était. Tant pis si mon nom reste entaché à jamais, ce n’est là que la punition que je mérite. Quand j’aurai fini d’écrire cette confession, je la glisserai dans la boîte de cerisier, par-dessus les lettres, dans l’armoire du couloir, sous les nappes du dimanche. L’un de mes petits-enfants trouvera la boîte, et je leur fais assez confiance à tous pour qu’ils sachent quel usage en faire.
Quand la guerre a éclaté, en 39, j’avais onze ans. Il faut bien avouer qu’une fois le premier choc de la nouvelle passée, ça n’a pas changé grand-chose à nos petites vies calmes. Le village a continué son train-train, entre soin des bêtes, des champs, et messes du dimanche. La guerre apportait de nouveaux sujets pour relancer les conversations le soir, un coude sur le comptoir de chez René, pendant que nous autres gamins, tournions en piaillant sur la place. Les mêmes rivalités amicales se jouaient autour d’un verre de gros rouge qu’il s’agisse des boches ou de la plus belle vache du canton.
Des Allemands, nous en avons vu passer quelques-uns, dans leurs belles autos rutilantes, tout de blondeur et de sourires. Ils ne s’arrêtaient pour ainsi dire jamais, et les rares fois où ils le faisaient, un regard circulaire leur suffisait pour prendre la mesure de l’insignifiance du lieu, et ils repartaient, se fendant parfois d’une sucrerie pour les gosses qui trainaient là.
La guerre, pour nous, c’était surtout les nouvelles à la radio, aussi terrifiantes qu’une histoire de loup ou de croque-mitaine, mais également aussi inoffensives quand nous étions claquemurés bien au chaud dans nos maisons. Chez moi, on détestait les boches par principe, en mémoire du père de mon père, mort à Verdun. Adultes comme enfants n’avaient qu’une idée très vague des exactions allemandes, et ne s’y intéressaient pas plus que ça.
Pourquoi aurions-nous détesté les juifs, les communistes, ou les homosexuels, qui ne nous avaient jamais rien fait, et que nous n’avions jamais rencontrés ? Alors que les Fritz, là, nous pouvions trouver des raisons à la pelle ! Ces opinions étaient assez répandues dans le village, majoritaires même. Les querelles de bar portaient plus sur des points de détail, des chicanes gentilles, qui se finissaient toujours par une réconciliation et un vigoureux « Mort aux schleus ! » bien senti.
Aussi le choc fut grand quand ma grand-mère maternelle commença à clamer en 41 à qui voulait bien l’entendre son amour des Allemands et sa conviction qu’ils avaient mille fois raison. Un tremblement de terre dans notre petite communauté. Aurait-elle eu 20 ans, et qu’un amour passionné pour un bel officier bien bâti l’aurait égarée, elle aurait eu la sympathie du village, toujours prompt à s’enflammer pour de belles romances. Mais là, à presque soixante-dix ans, aucune circonstance atténuante ne pouvait lui être trouvée.
A mon âge, je ne prêtais pas toujours une attention très soutenue aux adultes, mais, bientôt, je ne pus ignorer la grogne qui montait dans le village contre ma grand-mère. Personne n’osait trop la remettre à sa place, de peur que ses allégations de copinage avec la Kommandantur de Bordeaux ne soient pas le fruit d’une sénilité inattendue, mais bien la vérité. Au demeurant, quand elle affirmait que le commandant en chef ne voulait qu’elle pour préparer les foies gras qu’il faisait venir des Landes (d’où elle était originaire), tout le monde la croyait bien volontiers. Ma grand-mère était un fin cordon bleu, capable de tirer des saveurs insoupçonnées de la plus vulgaire tranche de viande.
Nous prîmes l’habitude de la voir disparaître quelques jours par mois, partie pour Bordeaux, nous imaginions des fêtes dignes de bacchanales romaines, où elle officiait en cuisine pour ravir les rustres palais teutons. Elle en revenait fatiguée, creusée, et nous la soupçonnions de prendre part aux orgies de l’occupant.
Ma mère ne décolérait pas, le comportement de sa mère devenait une obsession qui la rendait irritable, et dont ma sœur et moi faisions les frais à tout moment. Si nous faisions une rature sur nos cahiers d’écriture, nous nous prenions une taloche vicieuse, décochée par derrière, agrémentée d’un « on commence comme ça, et on finit collabo, appliquez-vous, graines de voyous ! »
Si nous avions le malheur de renverser le seau de la traite, elle gueulait « Allez-y ! Gâchez du bon lait ! Quand on crèvera de faim, vous n’aurez qu’à aller mendier chez les copains de votre grand-mère ! »
Le jour où le curé vint la voir pour lui dire que je m’étais endormi pendant le catéchisme, elle me secoua comme un homme qui meurt de faim secoue un pommier pour en faire tomber le dernier fruit. « Comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Tu dois être exemplaire ! Parfait ! Ta grand-mère a mis une tache sur le nom de la famille, tu dois la laver en étant irréprochable. I-RRE-PRO-CHA-BLE ! Tu m’entends ? Tu m’entends ? »
Malgré tout, les relations n’étaient pas encore complètement coupées entre mère et fille. Ma grand-mère pouvait encore franchir le seuil de notre porte, pour nous amener salades croquantes, bouquets de carottes éclatantes, persil odorant, les produits du potager qui amélioraient sensiblement notre existence. Mon père était menuisier, et nous avions une maison de village, flanquée d’une grange qui lui servait d’atelier. Une maigre bande d’herbe jaunâtre et pelée délimitait notre propriété, qui donnait sur la place, face au boulanger.
Ma mère s’acharnait à faire pousser des fleurs sur cette bande, qui s’acharnaient à bien vite crever. Je savais que la vie de la ferme lui manquait, et qu’elle attendait avec impatience les livraisons rituelles de nourriture. Quand mon grand-père tuait le cochon, les meilleurs morceaux atterrissaient toujours sur notre table. Finalement, en dépit de ses grandes tirades colériques, ma mère savait qu’elle dépendait trop de sa mère pour pousser la discorde jusqu’à la rupture.
Un jour de 43, inquiète d’apprendre qu’un voisin passé devant la ferme de ses parents avait vu les volets tirés en plein midi, elle enfourcha sa bicyclette et se rendit chez ses parents, me jetant presque derrière elle sur le porte-bagages. Nous trouvâmes porte close et elle dut ouvrir avec sa clé. Dans la cuisine, la vaisselle de la veille, laissée crasseuse dans l’évier, de grosses mouches dessus, la motte de beurre ramollie sur la table, et la miche sortie du torchon. Elle grimpa à l’étage d’un pas si lourd d’appréhension, si éloigné de son habituel sautillement léger, que je devinai un peu de ce qu’elle allait trouver.
« Reste là, Henri, attends-moi. »
Le grand-père était mort, affalé sur son tapis troué aux mites, de retour sûrement d’un voyage au pot de chambre. Le coup d’œil rapide que je pus jeter un peu plus tard me le révéla cul à l’air, les mains crispées sur sa braguette, la mort l’ayant saisi avant qu’il n’ait pu se reboutonner. Ma grand-mère ne rentra que deux jours plus tard, d’un énième séjour à engraisser l’ennemi. Plus que la perte de son père, plus vieux que sa femme d’une douzaine d’années, et par conséquent logiquement avec déjà un pied dans la tombe, c’est le ridicule de sa position que ma mère ne put pardonner.
Si ma grand-mère avait été là, elle aurait pu redonner une position respectable au grand-père, avant que quiconque ne le vît et que la rigueur ne s’empare de son cadavre. Alors que là, le médecin, puis les sœurs venues pour nettoyer et habiller sa dépouille, plus les employés des pompes funèbres, tous l’avaient vu dans cette position dégradante.
« Comme si ça ne suffisait pas de nous faire honte par ses paroles, elle a laissé humilier mon pauvre père. Oh, je le sais bien que ce pauvre homme est mort du chagrin et de l’infamie de la conduite de sa femme. Elle a tué mon père ! Aussi sûrement que si elle lui avait planté une hache en plein cœur », répétait ma mère à toutes les oreilles qui voulaient bien l’entendre.
Ma sœur et moi continuions à rendre visite à ma grand-mère, sans que ma mère ne nous en empêche. Elle refusait désormais de lui parler, et de lui ouvrir sa porte. Alors c’était à nous, les enfants, de faire en sorte que le flot de victuailles continue de couler. Nous nous chargions d’autant plus volontiers de cette corvée que l’affection silencieuse de notre grand-mère nous paraissait une oasis de bonheur comparée aux vitupérations incessantes de notre mère.
Et puis, nous pouvions ainsi contrôler les menus quotidiens, en refusant de ramener à la maison les légumes qui nous déplaisaient. Cela faisait rire grand-mère aux éclats, et elle nous serrait contre elle, à nous en étouffer.
Quelques mois avant la libération de Bordeaux, à la fin du printemps 44, je coupai à mon tour tous les ponts avec ma grand-mère. J’avais grandi, j’approchais de l’âge d’homme, et j’étais plus à même de comprendre le sens de ce que nous entendions à la radio, je saisissais l’horreur des évènements qui étaient rapportés. Le village bruissait des rumeurs d’extermination, même si nous avions du mal à croire à de telles atrocités. Le curé fit un vibrant sermon un dimanche, et nous apprit le massacre perpétré par les troupes allemandes dans un village distant d’à peine deux cents kilomètres de nous.
Après Oradour, le massacre d’un village entier en une journée, comment douter de la possibilité du massacre d’un peuple entier en quelques années ? À la sortie de la messe, ma mère m’envoya acheter la miche hebdomadaire, et je me mis dans la queue qui sortait de la boulangerie pour se répandre sur la place. J’avais le cœur lourd de ce que je venais d’entendre, mon jeune cerveau luttait pour appréhender la notion de génocide. Je regardais les gosses jouer à la balle et sauter à la corde, indifférents aux houspillements de leurs mères, qui craignaient qu’ils ne gâtent leurs habits du dimanche.
Je ne pouvais réconcilier cette image de paix domestique innocente avec celles que le curé avait créées dans mon esprit. La queue avançait lentement, chacun prenant une ou deux minutes pour cancaner avec la boulangère. Devant moi, mes concitoyens discutaient des faits, de la fin de la guerre que tous espéraient proche, de ces juifs qu’on disait assassinés dans toute l’Europe.
La voix de ma grand-mère, claire et pleine de défi, retentit.
« Les juifs, c’est que de la racaille, des voleurs. Et l’odeur de ces gens, mon Dieu, l’odeur… »
Un silence pesant tomba, les gens se regardaient, ne savaient comment réagir. Je quittai ma place dans la queue, m’approchai de ma grand-mère, et lui crachai un énorme glaviot en pleine figure. Elle me regarda, les yeux emplis d’une tristesse insondable et que je ne m’expliquai pas. Elle sortit son mouchoir de sa manche, s’essuya, sans cesser de me regarder, puis s’éloigna à petits pas, son chapeau de guingois. Tout le village se mit à applaudir, sans qu’un mot ne soit prononcé, on me tapa dans le dos, et la boulangère me donna une belle miche bien craquante sans accepter mes pièces.
Je ne revis ma grand-mère qu’une seule fois, car elle ne remit plus jamais les pieds au village. Bordeaux fut libérée à la fin du mois d’août, et quand il fut certain que les Allemands étaient partis, bien partis, le temps vint d’écrémer la population, de punir les brebis galeuses. Tout le monde a entendu parler de ces femmes tondues, de ces pendaisons expéditives, sans procès. Des actes souvent aussi abominables que ceux que l’on reprochait aux Allemands, mais dont les gens avaient besoin pour tirer un trait.
Notre village se découvrit ravi d’abriter une collabo en son sein, et une expédition punitive fut montée pour châtier ma grand-mère, à laquelle je me joignis, fier de commencer ma vie d’homme par une entreprise que je considérais comme vertueuse. En gueulant et en agitant des bâtons dans l’air, nous fûmes une bonne quarantaine à nous engager dans le chemin menant à la ferme. Ma grand-mère n’avait plus de chien, mort l’hiver précédent (« lui aussi, il a crevé de chagrin » avait dit ma mère), et nous pénétrâmes sans encombre dans la cuisine sombre et déserte.
La porte de la cave était grande ouverte, et deux voix de femme s’en échappaient, dont celle de ma grand-mère, parlant allemand. Une fureur brûlante éclata en geyser dans mon ventre, remonta en vagues bouillonnantes jusque dans ma gorge, puis éclata en un cri rageur.
« Putain, elle cache une boche en plus ! La pourriture, la pourriture… »
Poings et dents serrés, je me précipitai dans l’escalier de bois, martyrisant le bois branlant de mes lourds godillots. Une jeune femme, presque une fille, était assise sur le bord d’une paillasse, et ma grand-mère lui tenait la main. Elles me regardèrent toutes les deux en clignant des yeux de surprise, des lapins pris dans les phares d’une voiture. Des hommes m’avaient suivi, et ils saisirent ma grand-mère et la fille, leur firent remonter l’escalier en quatrième vitesse. Ma grand-mère se débattait, elle tenta de me saisir au passage, elle hurla :
« Henri ! Henri ! Écoute-moi, ce n’est pas ce que tu penses, ce que tu crois. Laisse-moi t’expliquer. Henri ! Henri !!! »
Je ne répondis pas, et regardai le courroux modéré de la foule glisser vers la folie en quelques minutes, et la tonte initiale se transformer en double meurtre à coups de bâtons, de godasses, jusqu’à ce que le corps des deux femmes ne soit plus qu’une pulpe méconnaissable, et que l’odeur métallique du sang recouvre celle de la sueur.
Quand je repense à cette journée, le dégoût et la honte m’envahissent de nouveau, et je ne trouve de consolation que dans le fait de n’avoir pas porté un seul coup. Maigre consolation.
Le cadavre de ma grand-mère et celui de l’inconnue ne furent pas enterrés, et quand je pris possession de la ferme quelques semaines après, je me contentai de jeter leurs restes sur le tas de purin.
Environ deux ans après la guerre, les lettres ont commencé à arriver, adressées à Germaine Trévillon, ou à Louis Trévillon, ou à Madame et Monsieur Trévillon… Des lettres aux timbres furieusement exotiques pour le petit campagnard que j’étais. Angleterre, Etats-Unis, Canada, Australie, Italie, Allemagne, quelques-unes de France. Des lettres magnifiques, émouvantes, qui me faisaient pleurer pendant des heures. Tous ces gens, ces hommes, ces femmes, ces enfants, 213 au total si j’ai bien compté, ces juifs que ma grand-mère a hébergés, nourris, et convoyés jusqu’à l’océan, pendant toute la durée de la guerre. Ces visages souriants sur les photos glissées entre les pages des missives. Ces bébés qui ne seraient jamais nés si ma grand-mère n’avait pas décidé de faire quelque chose pour lutter contre l’occupant, toute seule, à sa façon. Ces étrangers terrifiés, hagards, qu’elle a recueillis, nourris de ses produits, avant de les emmener, à pied, à travers la campagne, jusqu’à des bateaux qui les ont emmenés au loin. Une petite mémé qui chemine pendant des heures.
Je n’ai jamais répondu à aucune des lettres, mais je les ai toutes ouvertes, toutes lues. Elles se sont taries peu à peu, mais quelques personnes ont continué à en envoyer, sans poser de questions, se contentant de raconter leur nouvelle vie, de décrire tout ce qu’ils accomplissaient grâce à la bonté de ma grand-mère. Comme s’ils savaient que leurs lettres étaient lues, et qu’ils ne voulaient pas rompre le lien. Une certaine Rebecca en a envoyé jusqu’en 53, puis plus rien.
Je n’ai jamais rien dit, pas même à maman. Je ne voulais pas qu’elle passe ses vieux jours à ruminer, à revivre ces années noires. Je ne voulais pas qu’elle comprenne que si sa mère n’avait jamais rien dit, c’était à coup sûr pour ne pas nous mettre en danger, et parce qu’elle savait qu’elle aurait insisté pour aider.
Et puis, quand ma mère est morte, j’ai continué à me taire. J’avais honte. Toute ma vie, j’ai bénéficié d’une place à part dans le village, une bienveillance des autres. J’étais celui qui avait eu le courage de faire ce qui était juste, ce qui était bien, celui qui avait risqué sa vie en crachant au visage de Germaine. On me manifestait une cordialité permanente, on m’aidait à retaper la ferme, tâche ingrate pour un jeune de dix-sept ans livré à lui-même. Ma femme, je l’ai trouvée, et gardée, grâce à cette compassion. Elle était fille de notaire, et jamais on ne m’aurait laissé l’épouser si je n’avais pas été entouré de cette aura de courage et cet héroïsme par ricochet.
Quand je me suis saoulé parfois, on ne m’en a pas tenu rigueur, on chuchotait qu’avec mon passé, j’avais bien droit à relâcher la pression de temps à autre. Mes enfants ont accepté mes silences et mon renfermement, mis sur le compte du traumatisme familial. J’ai fait de mon mieux pour mener une bonne vie, pour respecter les autres autour de moi, pour remplir mes devoirs envers ma famille, ma terre, mes animaux. J’ai envoyé de l’argent pour aider les juifs après la guerre, des petites sommes, quand je le pouvais. Ensuite, j’ai donné à toutes les causes justes que j’ai croisées : défense des animaux, des enfants, recherche médicale.
Tout ça n’a servi à rien, on n’efface pas la souillure d’une existence toute entière basée sur le mensonge. La jeune fille blonde à qui je n’ai jamais donné de sépulture, dont je n’ai jamais recherché les origines ou la famille, me pardonnera-t-elle ? Ma grand-mère, à qui je n’ai jamais accordé le bénéfice du doute, dans mon arrogance d’adolescent, me pardonnera-t-elle ? Mon grand-père, qui a soutenu sa femme et l’a aidée à sauver tous ces gens, me pardonnera-t-il ? Et moi ? Me pardonnerai-je ?
Et vous, mes enfants, et vos enfants, et leurs enfants après eux, me pardonnerez-vous ?
Je vais ranger ces feuillets dans la boîte, et espérer que le curé m’a menti, qu’il n’y a pas de vie après la mort, car sinon je suis certain de passer l’éternité en enfer.
Bien à vous,
Henri.
Ce texte « Dans l’armoire du couloir, sous les nappes du dimanche » est publiée avec l’aimable autorisation de Céline Saint-Charle.
© Céline Saint-Charle – tous droits réservés, reproduction interdite.
Site officiel Céline Saint-Charle
Nous retrouver sur FB, instagram, twitter